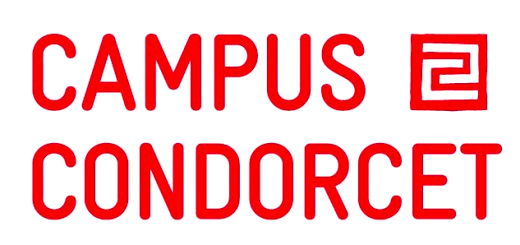Membres du Ladyss impliqués
Blandine Veith, Bezunesh TAMRU, Jean GARDIN
Coordinateur du projet
Bernard CALAS (Les Afriques dans le Monde)
Participants du projet extérieurs au laboratoire
Lucie DEMETTRE (Université Bordeaux Montaigne), Olivier BALLESTA (Université de Bordeaux Montaigne), Véronique ALFAURT (CNRS), Béatrice PLOTTU (Université d’Angers), Caroline WIDEHEM (AGROCAMPUS Ouest), Cristiana OGHINA-PAVIE (Université d’Angers), Nathalie FERRAND, Aurélie HESS (CNRS), Agnès GRAPIN (AGROCAMPUS), Fabrice FOUCHER (INRA), Alix PERNET (INRA), Jérémy CLOTAULT (Université d’Angers), Annie CHASTELLIER (INRA), Tatiana THOUROUDE (INRA), Gilles MICHEL (INRA), Julien JEAUFFRE (INRA)
Partenaires
IAM Les Afriques dans le monde, IRHS (Institut de Recherche en Horticulture et Semences), TEMOS, GRANEM, LAM, CERHIO, GDO-IHRS
Résumé du projet
Objets vivants de culture et de nature, les plantes ornementales sont entrées dans le domaine du patrimoine dans les années 1970-80. Redonnant valeur à des variétés tombées en désuétude, cette patrimonialisation se nourrit d’une critique esthétique de l’offre horticole et d’une critique de la marchandisation. L’originalité de la création dans ce secteur est son caractère hybride, à la fois création à vocation esthétique et obtention fondée sur des savoirs génétiques. RosesMonde s’intéresse à cette hybridité créative et à son intrication avec les logiques de patrimonialisation et de marchandisation du capitalisme esthétique, à travers un produit : la rose, au carrefour des industries culturelles et de l’agro-business. Comment la création variétale rosicole enregistre-t-elle la tension entre marchandisation et patrimonialisation, au cœur des dynamiques sociales et politiques actuelles ?
Pour répondre à cette question, un consortium associant des chercheurs en SHS (géographes, historiens, économistes et sociologues) à des généticiens mettra en œuvre une approche comportant trois entrées : par les variétés, par les acteurs, par les lieux, avant de déboucher sur des études de cas à valeur heuristique et synthétique.
L’entrée par les variétés sera centrée sur la diversité variétale, considérée comme construction. A partir des sources historiques et des ressources génétiques, les obtentions du XXe siècle seront étudiées pour mesurer la diversité génétique (marqueurs microsatellites, SSR), phénotypique (formes, couleurs, parfum, port, etc.) et culturelle (critères de sélection liés aux modes, usages, exigences de production et de consommation). L’analyse génétique portera sur 1400 variétés postérieures à 1900 choisies en fonction de leur représentativité pour les différents segments du marché, à différentes dates. Un sous échantillon de 384 individus permettra le séquençage des gènes intervenant dans des caractères esthétiques et agronomiques. Ces analyses pointeront les facteurs de l’innovation lors de la création variétale, en croisant les données de la base génétique utilisée par les obtenteurs et leurs critères de sélection, notamment esthétiques et culturels.
En effet, à partir d’enquêtes auprès des obtenteurs, éditeurs, producteurs, français, européens et africains, l’entrée par les acteurs tentera de comprendre la construction de leurs cahiers des charges et la hiérarchisation de leurs critères de sélection et de création. En croisant approches économiques et sociologiques, on comprendra les logiques sociales, esthétiques voire éthiques de la création et les modalités de son insertion dans la dialectique marchandisation/patrimonialisation, de sa rémunération par la PI et de ses effets dans les chaines de coopération. Une enquête complémentaire utilisera trois bases de données (INRA, OCVV, BVD) pour cerner la diversité des entreprises créatrices.
L’entrée par les lieux mobilisera plusieurs échelles. D’abord, l’échelle globale pour voir où sont produites quelles variétés, par quels types d’entrepreneurs ? Ensuite, l’échelle métropolitaine, travers les exemples aquitain et parisien, pour cartographier la mise en marché, l’offre variétale et leurs contextes métropolitains et lier distinction esthético-consumériste et dynamiques socio-spatiales. La comparaison circuits courts et circuits longs soulignera combien les critères « écolo-nomiques » se combinent aux critères esthétiques pour hiérarchiser et segmenter la demande.
Enfin, des études de cas synthétiques s’intéresseront à des variétés, des acteurs et des événements- emblématiques qui incarnent les logiques de patri-marchandisation comme les processus de co-construction de la création.
Au total, nous observerons la création rosicole condenser les paradoxes du Monde contemporain et en exprimer les ambiguïtés socio-politiques dans le sens où la démocratisation consumériste semble y accélèrer l’utilisation des critères patrimoniaux et environnementaux à des fins distinctives.
(source : site de l’ANR – auteur Bernard Calas)
Mots-clés
roses, patrimonialisation, marchandisation, analyses génétiques, capitalisme esthétique
Publications