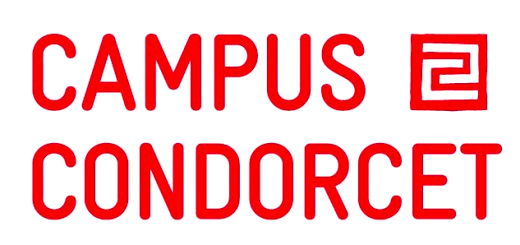– Lieu :
École nationale supérieure de chimie
11, rue Pierre et Marie Curie
75005 PARIS
Le territoire est omniprésent dans plusieurs des défis auxquels les sociétés contemporaines sont confrontées. Qu’il s’agisse du changement climatique ou de la transition énergétique, du vieillissement de la population, de l’accroissement des inégalités sociales, des rapports ville-campagne, des questions migratoires et identitaires, ou encore des nouvelles relations Nord-Sud, la dimension territoriale est souvent importante voire déterminante. Ce constat est-il suffisant pour justifier la mise en place d’un nouveau champ scientifique : les « sciences du territoire » ?
Cet intérêt pour le territoire pourrait surtout témoigner de l’avancée sur ce terrain des autres sciences (l’histoire, l’économie, la démographie, le droit, la science politique, l’agronomie, la climatologie etc.), et le réduirait à un simple objet multidisciplinaire. Autrement dit, le succès du territoire ne signalerait-il pas tout bonnement un ensemble divers de problèmes territoriaux posés aux sociétés et aux disciplines scientifiques existantes ?
A l’inverse, on peut considérer que le territoire constitue à la fois un révélateur puissant de la complexité contemporaine et une ressource pour l’action. Dans une société qui promeut la mobilité, l’accessibilité et la dérégulation, les instances productrices de normes, de repères et de recommandations se multiplient nécessairement. Il en résulte une complexité inédite dans laquelle le sens de l’action individuelle et collective n’est plus ni donné a priori, ni limité. Il se construit, se recompose, à toutes les échelles, rendant la cohérence de l’ensemble de moins en moins lisible.
Bien au-delà d’un simple objet multidisciplinaire, le territoire serait alors ce « révélateur » grâce à plusieurs qualités liées : la délimitation (tracée ou progressive, avec toutes les questions relatives aux seuils et aux effets frontière), qui peut contrecarrer l’accessibilité ; la matérialité du lieu, c’est-à-dire les caractéristiques (biologiques, physiques ou sociales) locales qui rappellent l’inertie structurante du temps passé et les rythmes spécifiques à chaque territoire ; les interactions (sociales, économiques, spatiales, politiques…), qu’elles s’exercent à l’échelle locale ou qu’elles articulent des échelles différentes, qui dessinent le territoire de manière particulière et non générique. Par ailleurs le territoire est de plus en plus mobilisé dans les représentations individuelles ou collectives (le territoire comme récit social susceptible de résoudre la complexité) ; dans l’allocation des ressources, des activités, et des responsabilités (le territoire comme choix structurant) ; et, enfin, pour l’action (le territoire comme principale assise de la légitimité).
L’analyse de ces qualités dépend centralement des informations territoriales disponibles (données statistiques, photographiques, iconographiques…), des catégories techniques, administratives ou politiques qui les encadrent, et de leurs méthodes de traitement.
L’information territoriale est partie prenante de la modification générale du rapport entre savoir et société : la société de la production du sens et du projet suppose la participation de tous les acteurs (débats sur la démocratie participative, sur la « démocratie technique »…). Du fait de sa complexité, le savoir est de plus en plus une affaire d’experts, or cette appropriation du savoir comme de la décision est de moins en moins admise. Porter le savoir à la connaissance large des acteurs nécessite de disposer d’outils de représentation du savoir, de visualisation des informations et des débats. Le territoire n’est-il pas une base pertinente de rencontre entre les savoirs et la « demande sociale » à travers le débat public ?
Succès grandissant des questions territoriales (environnement, développement, gouvernance, mobilités, relations internationales…), rôle du territoire comme révélateur de la complexité contemporaine, comme vecteur de la rencontre avec la demande sociale et comme ressource pour l’action collective : on conçoit que les disciplines scientifiques concernées par le colloque sont nombreuses. Celles qui se sont constituées avant tout sur un objet spatial (géographie, aménagement, urbanisme, architecture) et celles qui mobilisent une dimension spatiale (démographie, géopolitique, sociologie urbaine, économie spatiale…) apportent une contribution essentielle. Mais le champ des sciences du territoire intéresse bien d’autres sciences sociales (sociologie de l’action publique, économie institutionnaliste, droit de l’environnement, droit international…) ainsi que les sciences de la nature (hydrologie, géologie…), les sciences de la vie (biologie, agronomie, santé…), les sciences de l’ingénieur (géomatique, modélisation, systèmes complexes).
L’ambition du CIST est de montrer en quoi le territoire est une approche pertinente d’enjeux pluridisciplinaires tels que :
– l’articulation entre échelons individuel et collectif (parcours individuels et mobilités collectives, questions identitaires ; pratiques spatiales et fragmentation sociale ; politiques individuelles ou territoriales…) ;
– les nouvelles normes et régulations suscitées par la mondialisation (nouveau rôle de l’Etat et multiplication des producteurs de normes ; dépassement des régulations nationales par la montée du local et du transnational ; biens communs et gouvernance par la mobilisation multi acteurs…) ;
– les temporalités et ruptures dans les événements sociaux, physiques ou biologiques (vulnérabilité et risques ; sécurité, durabilité et résilience ; politiques de prévention et gestion des crises ; le besoin du temps long de la planification face à l’accélération des pratiques sociales…).
La rencontre entre les disciplines prendra des formes différentes selon que l’on envisage les sciences du territoire :
(i) soit comme un savoir scientifique. Les sciences du territoire sont alors envisagées à travers un ensemble de disciplines scientifiques que l’on confronte pour comprendre, de manière minimalement harmonisée, la dimension territoriale de leurs objets propres. Le concept de territoire sera discuté afin d’en constater les acceptions et les éventuels écarts d’une discipline à l’autre, et la prise en compte de l’espace obéira à des méthodes un tant soit peu comparables. Il faudra plutôt parler des sciences du territoire comme d’une méthodologie ;
(ii) soit comme une discipline scientifique émergente. Il faudra alors en définir les concepts, les lois et les méthodes d’analyse. L’énergie des chercheurs devra se concentrer sur le concept de territoire lui-même davantage que sur des grands enjeux cognitifs (le rapport individu-collectif etc.), ou plus précisément ces derniers fourniront l’occasion d’avancer dans une meilleure connaissance de l’objet scientifique qu’est le territoire.