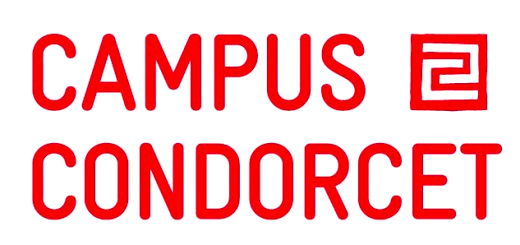Docteure en sciences (sociales) de l’environnement de l’Université de Lausanne
Chercheuse en humanités environnementales
ORCID: 0000-0003-4755-0272
Alternatives agricoles; alterpolitique; infrapolitique; Japon ; mésologie ; militantisme existentiel ; paysages nourriciers ; politique de préfiguration; permaculture ; satoyama; soi mésologique ; Suisse ; transition agroécologique; utopie concrète.
Actuellement : Chercheuse associée au Ladyss; et membre de l’équipe « Populations japonaises/Dynamiques territoriales » à Inalco/Infrae
Septembre 2024- Février 2025 : Collaboratrice scientifique à la Haute École de Santé et Travail Social (HESTL), Lausanne, pour le projet « Enhancing urban biodiversity and environmental justice: an inclusive approach » (dirigé par Prof.Béatrice Bertho)
Février 2023- février 2024 : Post-doc, Université de Reims Champagne-Ardenne – chargée de recherche pour le projet Âge2SCoT (dirigé par Dr Benoît Dugua) : la planification territoriale à l’épreuve de la transition agroécologique et du changement climatique.
2016-2023 – Doctorat en sciences de l’environnement au sein de l’Institut de Géographie et Durabilité de l’Université de Lausanne
Reviewer/évaluatrice pour les revues scientifiques : Cahiers Agricultures ; De Ethica ; La Pensée écologique ; People and Nature
Membre fondatrice de l’association faîtière Permaculture Romande (Permaculture.ch)
Anciennement: Membre de la Commission Manifestation de l’Institut de Géographie et Durabilité (Université de Lausanne): Groupe Agroécologie de l’Institut de Géographie et Durabilité (co-créé et co-animé par Andrea Mathez, Dominique Barjolle et Mathilde Vandaele)
2025 Chargé de cours « Agroécologies, engagements et paysages : excursions et cas d’étude », Université de Lausanne, FGSE, cours propédeutique de 1ère année Bachelor, semestre de printemps
2024 Chargée de séminaire pour le cours « Géographie, société, environnement: approches et théories contemporaines » (dirigé par Prof.M. Stock), Université de Lausanne, FGSE, cours propédeutique de 1ère année Bachelor, semestre d’automne
2017-2023 Interventions ponctuelles dans différentes universités (Cours d’économie domestique et permaculture à Kanazawa University Japan, Cours sur l’agroécologie et l’urbanisme agricole à Université Reims Champagne-Ardenne)
2021-2022 Assistante-tutrice pour le cours de Géographie pour 1ère année de Bachelor: « Milieu, Environnement, Territoire » (Prof.Mathis Stock et Dr. Arthur Oldra), Université de Lausanne, FGSE, semestre d’automne
2015-2021 – Assistante diplômée pour les enseignements et le suivi des mémoires de Bachelor et Master du Prof. Christian Arnsperger (Bachelor en géosciences de l’environnement + Master en Fondements et pratiques de la durabilité), ponctuellement pour Dre Joëlle Salomon Cavin. Faculté des Géosciences et de l’Environnement, Université de Lausanne. Intitulés des cours (sélection) :
Assistanat/enseignement/évaluation : Monnaie, Finance et Transition (Prof. Christian Arnsperger), Master 2ème année. Ce cours vise à offrir une compréhension globale des mécanismes de création monétaire dans les économies de marché capitalistes contemporaines; donner une bonne connaissance du « paysage » de la finance écologique et de ses opportunités aussi bien que de ses limites; souligner l’importance, pour les enjeux de transition écologique, des réflexions actuellement en cours (tant dans le monde académique que dans les cercles d’action citoyenne) concernant la réforme du système monétaire: étatisation de la monnaie (« Vollgeld/ Monnaie pleine ») d’une part, monnaies citoyennes complémentaires (MCL) d’autre part.
Assistanat/enseignement/évaluation: Durabilité et anthropologie économique (Prof. Christian Arnsperger), Master 1ère année. L’objectif de ce cours donné par Prof. Arnsperger est de montrer les liens étroits qui existent entre la figure de l’homo oeconomicus moderne et (i) le refus de la finitude de l’humain et (ii) la peur de la nature et de sa finitude, qui mènent tous les deux à une promotion aveugle de la croissance économique.
Assistanat/Tutorat/évaluation pour Durabilité et modes de vie (Prof. C. Arnsperger), 3ème année de Bachelor. L’objectif de ce cours est d’articuler les défis écologiques contemporains aux questions de changement de modes de vie dans nos sociétés dites « développées ». Étant donné que les budgets écologiques de la biosphère sont régulièrement dépassés, tant en termes de climat qu’en termes de flux de matières et en stocks de ressources non renouvelables, que peuvent faire les citoyenne-s-, les collectifs et les nations afin d’adopter des comportements et des normes de vie bonne qui permettent à l’humanité dans sa totalité de retourner durablement à l’intérieur des enveloppes ressourcielles de la planète?
Organisation/évaluation: Sciences de l’environnement : excursions (Prof. C. Arnsperger, Prof. N.Chèvre, Prof. Marie-Élodie Perga), 1ère année de Bachelor. Organisation de trois journées d’excursions pour des étudiants propédeutiques qui débutent un cursus dans la Faculté des Géosciences de l’Environnement (UNIL). Ces journées visent à mettre en lumière les alternatives écologiques qui émergent dans différents domaines et pousser les étudiants à avoir une réflexion critique et informée. Les excusions peuvent comprendre: une immersion dans une ferme en permaculture, la visite d’une banque alternative (éthique/écologique), la fabrication d’outils lowtech pour produire de l’énergie ou encore la visite d’un écoquartier urbain ou périurbain.
Séminaire en agriculture urbaine (Dr. Joëlle Salomon Cavin). Master, 2017. Co-création du séminaire sur la thématique annuelle « permaculture, ville et activisme »
Assistanat-expertise: Natures et formes urbaines (Dr. Joëlle Salomon Cavin). Master, 2016. Ce cours s’articule autour de quatre grands questionnements: Que signifient les notions d’écologie urbaine et d’agriculture urbaine ?; Comment les protecteurs de la nature influencent-ils la forme urbaine ?; Quelles pratiques agricoles se développent actuellement en ville ?; Comment l’aménagement urbain, à différentes échelles, intègre-t-il désormais l’agriculture dans sa conception ?
Thèse (soutenue en 2023) : « En quête d’autres milieux. La permaculture au prisme de la mésologie en Suisse et au Japon». Directeurs: Prof. Christian Arnsperger (Institut de Géographie et Durabilité, UNIL), et Dr. Yoann Moreau (Laboratoire d’Anthropologie politique, EHESS)
La multiplicité des définitions de la permaculture qui coexistent aujourd’hui complexifie sa délimitation, mais elle est aussi le signe du dynamisme des communautés qui s’en prévalent, la diffusent et la concrétisent, et ce faisant, l’adaptent et en renégocient le sens. Depuis sa conceptualisation en Tasmanie dans les années septante par Bill Mollison et David Holmgren, le concept de la permaculture s’est exporté et a inévitablement évolué. Que signifie la permaculture aujourd’hui ? Comment circule-t-elle ? Comment son sens est-il disputé, fragilisé, stabilisé ?
Cette thèse propose de suivre la permaculture en Suisse et au Japon et de raconter, à travers une série de récits, ce qu’elle y motive comme bifurcations, négociations et expérimentations. Ces pays offrent un contraste intéressant, car, bien qu’ayant une histoire différente des relations aux non-humains et d’évidentes spécificités territoriales et pédo-climatiques, ils sont tous deux confrontés aux limites écologiques et humaines de leur système agricole industrialisé et à la nécessité de la transformer à l’aune de ces limites. Un des objectifs était de mettre en lumière les diverses réponses et stratégies proposées par les permaculteurs et permacultrices face à cette situation.
Afin d’analyser les dynamiques par lesquelles la permaculture se concrétise de manière relationnelle et contextuelle, selon des trajectoires de vie, des lieux et des territoires, j’ai fait le choix de l’étudier au prisme de la mésologie. La mésologie, ou « étude des milieux humains », est une perspective développée par le géographe Augustin Berque, qui ambitionne de dépasser les dualismes du paradigme moderne grâce à des concepts radicalement relationnels : milieu, trajectivité, médiance. Elle offre ainsi des outils conceptuels et critiques à même de décrire les fluctuations du sens de la permaculture en fonction des milieux.
Tant la permaculture que la mésologie peut lue comme une quête d’autres milieux – autres que ceux du grand récit du progrès, du capitalisme et de la modernisation écologique, et autres que ceux qui se dessinent à travers l’esthétique d’effondrement brutal qu’évoque l’Anthropocène. Qu’est-ce que ces quêtes engagent comme vision du sujet et expérience de soi ? Afin de faire ressortir leurs implications existentielles, expérientielles et politiques, je propose le concept de « soi mésologique », que j’ai construit en m’inspirant du « militantisme existentiel » de l’économiste hétérodoxe Christian Arnsperger, du « soi écologique » du philosophe Arne Næss et du « militantisme spirituel » de l’autrice féministe queer décoloniale Gloria Anzaldúa.
L’objectif de cette thèse est triple : 1) explorer et conceptualiser une disposition de soi qui arrive à tenir la tension entre reconnexion au milieu et déconnexion au système, en d’autres termes, qui fasse preuve de d’acceptation critique et incarnée ; 2) mettre en évidence ce qui, dans la permaculture, s’apparente à cette disposition de soi, et en quoi cette dernière est motrice d’une transformation des milieux ; 3) mettre en lumière les paysages et frictions que la permaculture fait émerger à travers ces transformations.
L’approche méthodologique est une mésographie – une ethnographie mésologique. Elle consiste en des enquêtes de terrain basées sur de l’observation participante dans une trentaine de lieux et au sein de diverses associations et sur cinquante entretiens semi-directifs avec des pionniers, porteurs de projets et membres actifs.
Les apports principaux de cette recherche sont, 1) de raconter concrètement la permaculture par des « récits de milieux » qui permettent de saisir conjointement des trajectoires de vie et des trajectoires de lieu ; 2) de donner à voir, à travers des « récits de frictions paysagères », les opportunités de, et les obstacles au changement que chaque territoire apporte ; 3) de situer le « soi mésologique » à l’interface entre la critique existentielle du système dominant et une attention et un prendre-soin renouvelé aux vivants.
Activités de recherche transdisciplinaires
Actuellement engagée auprès d’acteurs du milieu artistique en tant que partenaire scientifique dans des projets transdiscplinaires ; collaboration arts-sciences et recherche commune d’autres épistémologies et relations au vivant; développement de nouvelles méthodologies incarnées et multiespèces, d’inspiration écosomatique (embodied science and multispecies studies and ethnography).
– Collaboration avec la chorégraphe Nicole Seiler autour de « Monologues », en s’inspirant des comportements d’oiseaux pour retravailler la relation corps-voix et les significations de « prendre la parole », « s’exprimer » ou « laisser parler » (2024-2025)
– Accompagnement du Festival d’art contemporain Far° à Nyon (Suisse) sur le projet « PERMA-CULTURE » et la transition vers un modèle organisationel perma-curatorial, aux côtés du chorégraphe Grégory Stauffer et du coach social Clément Demaurex (2022-2025)
– Collaboration avec la chorégraphe Ruth Childs autour de « Communauté discrète d’hippocampes danseurs », avec le support du Théâtre de Vidy Lausanne, qui adressait la problématique de la disparition des hippocampes et plus largement des espèces qui ne sont pas considérés comme indispensables. (2020-2021 + 2025)
Articles dans une revue
Chapitres d’ouvrage collectif